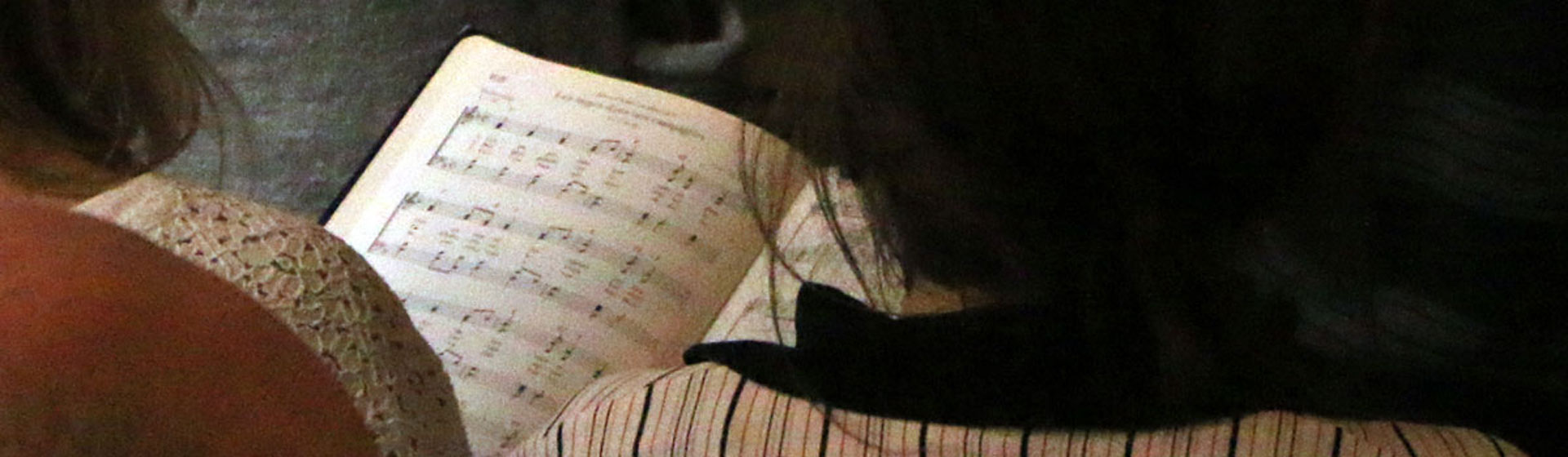|
PHILIPPE GONZALEZ |
Publié avec l'aimable autorisation des
Editions mennonites Art. paru dans : Christ Seul No 988 mai 2009 |
|
Ce que nous chantons nous influence beaucoup. Le contexte culturel influence beaucoup ce que nous chantons. Prise de conscience ?
Contre toute attente, l'interprétation de chants semble mieux adaptée à la transmission d'idées que la prédication. Car, pour apprendre un cantique, il faut le répéter jusqu'à ce que sa mélodie nous soit familière. Au cours de ce processus, les paroles du chant auront été répétées à plusieurs reprises. Une fois appris, il fera partie de notre répertoire. Par comparaison, il est rare qu'un prédicateur répète une prédication au même auditoire.
Les différences portent aussi sur la façon dont le message est communiqué. Dans le cas du sermon, autrui me partage le fruit de sa méditation des Écritures. Le message vient de l'extérieur. Je le reçois dans une situation d'écoute passive. À l'inverse, lorsque j'interprète un chant, tout mon corps est sollicité : mes cordes vocales, mon souffle, mes membres. C'est ma propre voix qui proclame les paroles du chant, comme si elles venaient de mon intériorité, même si un autre les a composées. Le cantique laissera une empreinte plus forte sur nous, parce que l'interprétation mobilise plus fortement notre expérience.
STYLES MUSICAUX
Venons-en aux paroles du chant et au style musical. La combinaison entre un certain contenu théologique et des choix musicaux débouchera sur une spiritualité. Ainsi comprise, la spiritualité est une manière de traduire et d'exprimer des réalités spirituelles dans l'existence du croyant. La force du chant, c'est que cette transformation de vérités théologiques dans le vécu de l'interprète passe par le sentiment esthétique. La spiritualité est alors la manière dont on interprète, on incarne, des vérités spirituelles.
Cette spiritualité peut être mise en relation avec les divers styles musicaux et de piété qui émaillent l'histoire de l'Église. Pensons aux liens entre le chant bénédictin et la vie monastique, le choral luthérien et la Réformation, le gospel et la ferveur émancipatrice des Noirs étasuniens. Autant de manières de vivre et de concevoir le christianisme.
Des différences similaires se retrouvent dans nos communautés et s'expriment souvent en termes d'écarts entre les générations ou de clivages entre les sensibilités spirituelles. Ainsi, la spiritualité qui traverse « Les ailes de la foi » ou « À toi la gloire » plonge ses racines dans les mouvements de réveil du XIXe siècle.
"J'AIME L'ETRENEL"
Quant aux « J'aime l'Éternel », le premier volume est en phase avec les mouvements des « Jesus People » des années 1970, alors que les éditions suivantes témoignent des inflexions de la spiritualité charismatique depuis les années 1990. D'un recueil à l'autre, ce n'est pas simplement le nombre et la longueur des strophes qui ont changé. C'est aussi la façon d'exprimer – et de faire l'expérience – de Dieu, du Christ, de l'Église et du monde qui nous environne.
POUR ALLER PLUS LOIN...
Une version longue de cet article est à lire sur le site du Centre Mennonite de Paris et est paru dans Perspective, mensuel des Eglises mennonites de Suisse.